La loi Duplomb : comment l'échec de la gouvernance intersectionnelle a créé une catastrophe de santé publique
- Dr Audrey-Flore Ngomsik
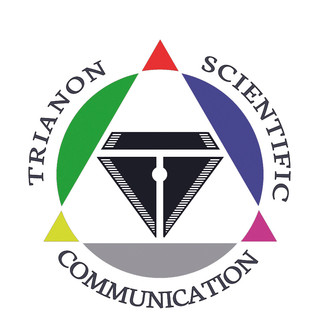
- 12 juil. 2025
- 13 min de lecture
Quand la politique ignore la science
Le 8 juillet 2025, le Parlement français a adopté une loi qui restera dans les mémoires des générations futures comme un exemple désastreux de mauvaise gouvernance. Elle incarne toutes les failles de notre façon de décider des questions relatives à la politique agricole, à la préservation de l'environnement et à la santé publique. La santé de millions de Français est directement menacée par cette modification réglementaire scandaleuse, présentée comme un « soutien aux agriculteurs ».
Soyons clairs : cette loi tuera des gens. Pas immédiatement, ni de façon spectaculaire, mais lentement et systématiquement, par le biais de cancers, de lésions neurologiques et de troubles de la reproduction. Et le plus tragique, c’est que cela aurait pu être évité.

Le retour du poison : ce que fait réellement la loi Duplomb
À la base, la loi Duplomb fait trois choses dévastatrices : [1]
Premièrement, elle ramène les « tueurs d'abeilles ». La loi réautorise les néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, un insecticide toxique pour le cerveau, interdit en France depuis 2018. Ces produits ne sont pas seulement nocifs pour les abeilles, ils sont également nocifs pour le cerveau humain, en particulier pour les cerveaux en développement.

Deuxièmement, il accélère l'expansion de l'agriculture industrielle en simplifiant les permis pour les méga-élevages et les réservoirs d'eau, privilégiant la production à court terme au détriment de la durabilité à long terme. C'est une folie climatique déguisée en progrès.
Une seule ferme porcine industrielle abritant 40 000 animaux produit plus d’équivalent CO2 que 15 000 voitures circulant pendant un an.[2]
La France construit des centrales à charbon qui produisent du porc. Or, la science est claire comme de l'eau de roche : nous n'avons pas besoin de plus de viande, mais d'une viande de meilleure qualité.
Une vache nourrie à l’herbe produit 40 % de méthane en moins qu’une vache élevée en usine, tout en offrant une nutrition supérieure et en soutenant la biodiversité.[3,4,5]
Mais au lieu d'aider les agriculteurs à passer à des pratiques régénératrices qui pourraient faire de la France un leader en matière de protéines durables, la loi Duplomb redouble d'efforts pour renforcer le modèle industriel qui cuit notre planète tout en produisant des aliments de qualité inférieure.
Troisièmement, elle supprime la séparation entre la vente de pesticides et le conseil agricole. La loi met fin à l'obligation de 2018 de séparer la vente de pesticides du conseil agricole, supprimant ainsi un obstacle crucial à l'influence de l'industrie agrochimique.
Imaginez si les laboratoires pharmaceutiques pouvaient conseiller directement les médecins sur les médicaments à prescrire tout en les vendant. C'est exactement ce que cette loi autorise pour les pesticides.
Nous avons déjà vu ce scénario, c'est le même stratagème qui a alimenté l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis.[6] Les sociétés pharmaceutiques comme Purdue Pharma ne se sont pas contentées de vendre de l'OxyContin ; elles ont directement conseillé les médecins sur sa prescription, minimisant ainsi les risques de dépendance tout en maximisant les ventes.
Le résultat ?
Plus de 645 000 décès et ce chiffre continue d’augmenter.[7]
La France accorde désormais le même pouvoir aux entreprises agrochimiques, leur permettant à la fois de vendre des pesticides et de conseiller les agriculteurs sur leur utilisation. La seule différence est qu'au lieu d'addiction, on parle de cancer, de lésions cérébrales et de dégradation environnementale.
La science est claire : ces produits chimiques nous tuent
Un nombre croissant de recherches scientifiques démontrent sans équivoque que les pesticides néonicotinoïdes, dont l'acétamipride et l'imidaclopride, présentent de graves risques pour la santé humaine. Ces composés sont reconnus comme des perturbateurs endocriniens, et des études indiquent qu'ils peuvent favoriser les cancers hormonaux, comme le cancer du sein, en interférant avec les voies de signalisation des récepteurs aux œstrogènes.[8]
De plus, les néonicotinoïdes ont été associés à une toxicité pour la reproduction, notamment une diminution de la fertilité et des effets indésirables sur le développement des organes reproducteurs dans les modèles animaux.[9]
Ironiquement, même si les pesticides nuisent à la fertilité, la société continuera à reprocher aux femmes de « ne pas avoir assez d’enfants », ignorant les facteurs environnementaux qui contribuent à ce déclin.
Les néonicotinoïdes traversent facilement les barrières biologiques critiques, notamment la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'exposition prénatale. Des données expérimentales montrent que l'acétamipride et l'imidaclopride agissent comme agonistes des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (nAChR), imitant les effets neuroactifs de la nicotine sur le cerveau en développement.[10]
Cette activation des récepteurs pendant les périodes critiques du développement neurologique peut perturber la formation des circuits neuronaux, entraînant potentiellement des déficits cognitifs et comportementaux.[8,9]
Au-delà de leurs effets sur le développement neurologique, les néonicotinoïdes ont été associés à diverses toxicités systémiques. Des études animales ont fait état de lésions hépatiques, d'une génotoxicité et d'un potentiel cancérigène liés à une exposition chronique.[11]
Il est important de noter que des études de biosurveillance humaine ont détecté de multiples néonicotinoïdes dans des échantillons de liquide céphalo-rachidien, de plasma et d’urine d’enfants, confirmant que ces pesticides pénètrent dans le corps et s’accumulent dans les tissus critiques, y compris le système nerveux central.[12]
Les victimes : les agriculteurs d’abord, les autres ensuite
La Ligue française contre le cancer a spécifiquement averti que la loi Duplomb aggraverait l'exposition aux pesticides des agriculteurs et des riverains. Il s'agit d'une action de prévention contre le cancer qui tire la sonnette d'alarme, et non d'une campagne de peur environnementale.
Considérez ceci : la loi présentée comme aidant les agriculteurs leur portera le plus grand préjudice.
Les agriculteurs sont en première ligne face à l'exposition aux pesticides. Ce sont eux qui respirent ces produits chimiques, les manipulent quotidiennement et en subissent les conséquences. Les communautés rurales, où vivent les travailleurs agricoles et leurs familles, seront les plus touchées par l'augmentation des taux de cancer, des troubles neurologiques et des problèmes de reproduction.
Mais les dégâts s’étendent au-delà des agriculteurs.
Seulement 5 % environ des néonicotinoïdes appliqués sont absorbés par les cultures ; les 95 % restants pénètrent dans le sol et les eaux. Cela signifie que chaque citoyen français, y compris ceux éloignés des sites agricoles, sera exposé par l'eau potable contaminée, les résidus alimentaires et la dérive environnementale.
Entrons dans les détails :
Ce faible taux d'absorption entraîne une contamination généralisée des sols agricoles et des plans d'eau. Les néonicotinoïdes sont hautement solubles dans l'eau et persistants, ce qui leur permet de s'infiltrer dans les eaux souterraines et de surface, et de s'accumuler dans les sols au fil du temps. Des études ont détecté ces substances chimiques dans diverses matrices environnementales, notamment le sol, l'eau et même dans les plantes sauvages à proximité des champs traités.[13]
En raison de leur mobilité et de leur persistance dans l’environnement, les néonicotinoïdes peuvent pénétrer dans le corps humain par :
Eau potable : présente dans les sources d’eau publiques et privées, notamment dans les zones agricoles.[14]
Résidus alimentaires : présents dans une grande variété d’aliments, notamment les fruits et légumes et le miel, en raison de la contamination de l’environnement et de l’application directe.
Dérive environnementale : le mouvement de poussière et d’eau contaminées peut propager les néonicotinoïdes loin des sites d’application, augmentant ainsi le risque d’exposition pour la population générale.[15]
Nous avons déjà vécu cette situation : la catastrophe du chlordécone
Ce qui rend la loi Duplomb particulièrement exaspérante, c’est que la France a déjà vécu exactement ce cauchemar.
En Martinique et en Guadeloupe, le pesticide chlordécone a été largement utilisé dans les plantations de bananes de 1972 à 1993, malgré son interdiction aux États-Unis en 1976. Les autorités françaises savaient qu'il était dangereux mais privilégiaient les profits agricoles à la santé publique.
Le résultat ?
Une catastrophe qui continue aujourd’hui.
Quatre-vingt-quinze pour cent des adultes de ces îles ont du chlordécone dans le sang.
Les taux de cancer de la prostate sont parmi les plus élevés au monde.
Le sol reste contaminé pendant des siècles, le chlordécone a une demi-vie de 5 000 ans.
La pêche est toujours restreinte dans de vastes zones car le produit chimique a saturé l’écosystème marin.
Une génération entière d’enfants a été exposée à une neurotoxine qui affecte le développement cognitif.
Ce n’est pas de l’histoire ancienne, cela se passe en ce moment même, trente ans après que le produit chimique a finalement été interdit.
L'État français a dépensé des milliards en indemnisations et en efforts de nettoyage, et la crise est loin d'être terminée. Comment le même gouvernement, qui continue de financer la catastrophe du chlordécone, peut-il maintenant autoriser une nouvelle vague de produits chimiques toxiques pour le cerveau ?
C’est comme s’ils n’avaient rien appris en empoisonnant leurs propres citoyens dans les Caraïbes.
Les parallèles sont terrifiants : un produit chimique interdit ailleurs, les autorités ignorant les avertissements sanitaires, les communautés rurales les plus exposées et des décennies de dommages irréversibles. La seule différence est que cette fois, cela se produit sur le continent.[16]
Les alternatives qui ont été ignorées
Ce qui rend cette tragédie encore plus exaspérante : nous avons de meilleures solutions. L’UE a élaboré et mis en œuvre des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) qui réduisent la dépendance aux pesticides tout en préservant les rendements des cultures.
Il s'agit notamment de :
Lutte biologique utilisant des prédateurs naturels et des insectes utiles pour lutter contre les ravageurs. Des pays comme le Danemark et les Pays-Bas ont réussi à réduire l'utilisation de pesticides de 40 à 60 % tout en maintenant la productivité agricole.
Technologies d’agriculture de précision qui permettent une application ciblée des traitements uniquement là où cela est nécessaire, réduisant ainsi l’utilisation globale de produits chimiques jusqu’à 70 %.
Systèmes de rotation des cultures et de polyculture qui brisent naturellement les cycles des ravageurs, réduisant ainsi le besoin d'interventions chimiques.
Pièges à phéromones et techniques de perturbation qui empêchent la reproduction des parasites sans produits chimiques toxiques.
Création d’habitats bénéfiques qui encourage la lutte naturelle contre les ravageurs en soutenant la biodiversité dans et autour des exploitations agricoles.
Ce ne sont pas des solutions théoriques, elles fonctionnent déjà dans d'autres pays européens. La France aurait pu investir dans la transition des agriculteurs vers ces méthodes plutôt que de redoubler de dépendance aux produits chimiques.
L'échec de la gouvernance : comment l'intersectionnalité aurait pu nous sauver
La loi Duplomb représente un échec catastrophique de gouvernance, qui illustre parfaitement pourquoi nous avons besoin d’approches intersectionnelles dans l’élaboration des politiques.
Voici comment cette catastrophe s’est déroulée et comment elle aurait pu être évitée :
Réflexion sur un seul problème : la loi a été conçue uniquement comme un « soutien à l’agriculture » sans tenir compte des implications en matière de santé, d’environnement ou de justice sociale.
Une approche intersectionnelle aurait posé les questions suivantes : Qui supporte les coûts de cette politique ? Comment ces produits chimiques affectent-ils différemment les populations vulnérables ? Quelles sont les conséquences à long terme pour les communautés rurales, les enfants et les femmes enceintes ?
Exclusion des voix concernées : La loi a été adoptée « de force », au terme d'un processus hautement controversé et accéléré qui a limité le débat et exclu de nombreuses voix critiques. Cette violence procédurale a exclu les voix des experts en santé publique, des scientifiques de l'environnement et des communautés concernées. Une véritable gouvernance intersectionnelle aurait nécessité une participation significative de toutes les parties prenantes, en particulier celles les plus touchées par la décision.
Déséquilibre des pouvoirs : L'industrie agrochimique a exercé une influence disproportionnée sur l'élaboration de cette loi, tandis que les défenseurs de la santé publique, les groupes environnementaux et les communautés rurales ont été marginalisés. De fait, le processus législatif a été qualifié d'incongru et accéléré, des milliers d'amendements proposés par les défenseurs de la santé publique et de l'environnement ayant été rejetés ou n'ayant pas fait l'objet de débats constructifs. De plus, les groupes environnementaux et les scientifiques ont exprimé des inquiétudes quant à la réintroduction de pesticides interdits et à l'affaiblissement des protections environnementales, mais leur contribution a été largement mise à l'écart. Cette dynamique s'inscrit dans la lignée des tendances observées ailleurs, où le lobbying industriel et les intérêts économiques ont un fort impact sur les résultats des politiques, souvent au détriment de considérations plus larges de santé publique et d'environnement.
La gouvernance intersectionnelle aurait reconnu ces déséquilibres de pouvoir et les aurait activement corrigés en mettant l’accent sur les voix et les besoins des personnes les plus touchées.
Ignorer les impacts cumulatifs : La loi traite chaque problème de manière isolée, l’utilisation des pesticides, l’expansion du bétail, la gestion de l’eau, sans tenir compte de la manière dont ces éléments interagissent pour créer des dommages cumulatifs, en particulier pour les populations vulnérables.
À quoi ressemble l’innovation intersectionnelle
Selon Kimberlé Crenshaw, l’intersectionnalité étudie comment les systèmes oppressifs qui se chevauchent, tels que ceux fondés sur la race, le sexe, la classe et d’autres identités, créent des expériences distinctes de discrimination qu’il est impossible de comprendre en examinant chaque système séparément. |
Étant donné que les communautés agricoles, les consommateurs et les travailleurs se situent à l’intersection de plusieurs vulnérabilités telles que la précarité économique, l’exposition environnementale, l’isolement géographique et les disparités en matière de santé qui s’aggravent en fonction de facteurs tels que l’âge, le revenu, l’état de grossesse et la résidence rurale, ce cadre est pertinent pour la politique agricole.
Imaginez si la France avait abordé la politique agricole selon une perspective intersectionnelle. Au lieu de la loi Duplomb, nous aurions peut-être vu :
Soutenir les agriculteurs dans la transition vers des pratiques durables tout en protégeant leur sécurité économique, développé en partenariat avec les communautés agricoles, les experts en santé publique et les scientifiques de l'environnement.
Analyse de la manière dont les politiques agricoles affectent différentes communautés, avec une attention particulière aux enfants, aux femmes enceintes, aux familles à faible revenu et aux résidents ruraux ; en reconnaissant que les personnes à l’intersection de plusieurs catégories (comme les femmes enceintes à faible revenu dans les zones rurales) sont confrontées à des risques aggravés.
Réunir des experts en politique agricole, sanitaire, environnementale et sociale pour développer des solutions holistiques qui répondent simultanément à plusieurs défis.
Veiller à ce que les communautés concernées disposent d’un réel pouvoir dans l’élaboration des politiques qui affectent leur santé et leur environnement, et pas seulement d’une consultation symbolique ; en accordant une attention particulière à l’amplification des voix des intersections les plus marginalisées.
« …Parce que, quand on a une solution pour les plus invisibilisés, on a une solution pour tout le monde » - Dr Audrey-Flore Ngomsik
L'avantage concurrentiel de l'innovation intersectionnelle
Les critiques pourraient arguer que cette approche nuirait à la compétitivité de la France sur les marchés mondiaux. Ils ont tort. Voici pourquoi une gouvernance intersectionnelle créerait un avantage concurrentiel considérable :
Positionnement premium sur le marché : Les consommateurs européens paient de plus en plus cher les aliments produits de manière durable. Les exportations agricoles danoises sans pesticides se vendent 20 à 40 % plus cher que les produits conventionnels. La France pourrait dominer le marché européen croissant de l'alimentation biologique et durable, estimé à 50 milliards d'euros, au lieu de se lancer dans une course au nivellement par le bas sur le marché des matières premières.
Leadership en matière d'innovation : Les pays qui adoptent des approches intersectionnelles deviennent des pôles d'innovation. Les Pays-Bas ont réduit leur utilisation de pesticides de 60 % et sont devenus le deuxième exportateur agricole mondial grâce à l'agriculture de précision et aux biotechnologies. En intégrant les considérations sanitaires, environnementales et sociales, la France pourrait dominer le marché mondial des technologies agricoles, qui représente 200 milliards d'euros.
Arbitrage réglementaire : L'UE s'oriente de toute façon vers une réglementation plus stricte en matière de pesticides. La France pourrait prendre de l'avance, offrant ainsi à ses agriculteurs un avantage concurrentiel lorsque les autres pays seront contraints de rattraper leur retard. Les précurseurs s'accaparent des parts de marché tandis que les concurrents peinent à s'adapter.
Économies sur les coûts de santé : Une gouvernance intersectionnelle aurait calculé les coûts cachés de l’utilisation des pesticides, estimés à 2,3 milliards d’euros par an en France pour les soins de santé, la dépollution environnementale et les pertes de productivité. L’agriculture durable n’est pas plus coûteuse ; c’est un investissement rentable en termes de réduction des coûts environnementaux et sociaux.
Valeur de marque : Le « Made in France » pourrait devenir synonyme de santé, de durabilité et de qualité. Un positionnement de marque dont la valeur à l'exportation se chiffre en milliards. Au contraire, la loi Duplomb renforce l'image de la France comme un pays privilégiant les profits des entreprises à la santé publique.
La véritable question n’est pas de savoir si la gouvernance intersectionnelle est compétitive, mais de savoir si la France peut se permettre de prendre du retard sur les pays qui récoltent déjà les bénéfices économiques de politiques agricoles durables et soucieuses de la santé.
Il est encore temps d'agir
Bien que désastreuse, la loi Duplomb n’est pas irréversible.
Voici ce qui doit se produire :
Concernant les politiciens : vous avez le choix. Vous pouvez soutenir l’industrie chimique ou le bien-être de vos électeurs. En matière de produits chimiques cancérigènes présents dans notre alimentation et notre eau, aucun compromis n’est possible.
Concernant les agriculteurs : vous ne méritez pas d’être sacrifiés au nom des profits des entreprises. Encouragez l’adoption de méthodes durables qui préservent vos terres et votre santé. Nous pouvons nourrir les populations sans les empoisonner ; rejoignez les agriculteurs d’autres pays de l’UE qui le démontrent.
Citoyens : Cela a un impact direct sur la santé de votre famille. Parlez-en à votre député. Encouragez les groupes qui luttent pour la réforme des pesticides.
Conclusion
La loi Duplomb restera dans les mémoires comme un moment où la France a privilégié les intérêts à court terme des entreprises au détriment de la santé de sa population. Nous pouvons encore changer de cap, mais seulement si nous agissons maintenant.
La question n’est pas de savoir si ces produits chimiques causeront des dommages, la science est claire qu’ils le feront.
La question est de savoir si nous allons permettre à notre gouvernement de nous empoisonner à des fins lucratives, ou si nous allons exiger la gouvernance intersectionnelle et fondée sur la science que notre santé et notre démocratie méritent.
Cet article s'appuie sur des recherches scientifiques évaluées par des pairs et des rapports d'organisations de santé majeures. Nous encourageons nos lecteurs à consulter les sources originales et à dialoguer avec les décideurs politiques locaux pour plaider en faveur de politiques agricoles et sanitaires fondées sur des données probantes.
[3] Beauchemin, KA, McGinn, SM, 2006. « Émissions de méthane des bovins de boucherie : effets du régime alimentaire, de l'alimentation et de la gestion . » Agriculture, Ecosystems & Environment, 112(3), 291-301.
[4] Daley, CA, Abbott, A., Doyle, PS, Nader, GA, Larson, S., 2010. « Une revue des profils d'acides gras et de la teneur en antioxydants du bœuf nourri à l'herbe et au grain . » Nutrition Journal, 9, 10.
[5] Teague, WR, Apfelbaum, S., Lal, R., et al., 2016. « Le rôle des ruminants dans la réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture en Amérique du Nord. » Journal of Soil and Water Conservation, 71(2), 156-164.
[10] Matsuda, K., Buckingham, SD, Kleier, D., Rauh, JJ, Grauso, M., & Sattelle, DB (2001). « Néonicotinoïdes : insecticides agissant sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine des insectes . » Tendances en sciences pharmacologiques, 22(11), 573-580.
[11] Kim, KH, Kabir, E., et Jahan, SA (2020). Exposition aux pesticides et effets associés sur la santé humaine . Science of The Total Environment, 575, 525-535.





Commentaires